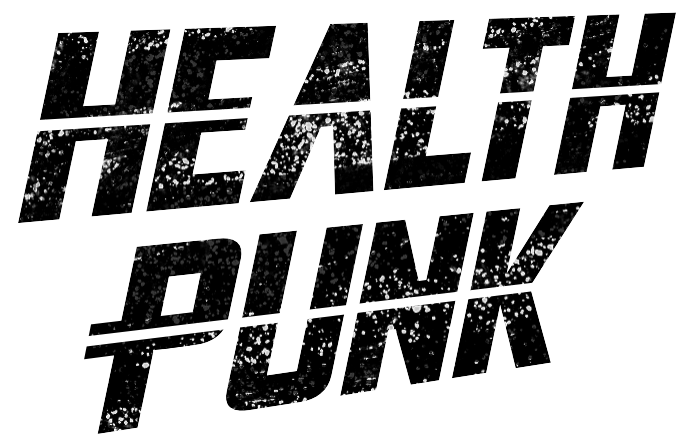Catastrophisme : éloge du désespoir
Pier-Luc Turcotte
De tous les genres artistiques, la science-fiction est depuis longtemps un puissant vecteur pour exprimer les angoisses inconscientes liées à l’existence humaine : angoisses face à sa propre mort et à l’extinction de l’humanité. Mon adolescence a été marquée par la série satirique québécoise Dans une galaxie près de chez vous. Diffusée à la fin des années 1990, la série se déroulait dans un futur pas si lointain, et sa séquence d’ouverture donnait immédiatement le ton :
« Nous sommes en 2034. La situation sur Terre est catastrophique : la couche d’ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l’industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat : la Terre se meurt sous les rayons du soleil. Il faut trouver une nouvelle planète pour déménager six milliards de tatas. C’est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l’univers. Là où la main de l’homme n’a jamais mis le pied. »
Cet univers humoristique a façonné mes propres angoisses existentielles — lesquelles se manifestent différemment selon les contextes historiques : la peur jadis urgente de la disparition de la couche d’ozone, une population mondiale désormais supérieure à 8 milliards, une « fédération planétaire » qui, malgré son unité, compte sur l’équipage le moins préparé du Canada pour sauver l’humanité, et surtout, peut-être, l’imminence d’une catastrophe autrefois perçue comme si lointaine.
Environ 25 ans plus tard, le drame post-apocalyptique The Last of Us a ravivé une fascination semblable. Réalisée par le créateur de la série Chernobyl, cette œuvre se déroule dans un monde postpandémique, ravagé par une infection fongique qui transforme les humains en créatures zombiesques et provoque l’effondrement de la civilisation. Regarder cette série dans un monde postpandémique, marqué par la résurgence des tensions nucléaires et la montée du fascisme à l’échelle mondiale, aurait facilement pu provoquer un désespoir insoutenable. Mais ce ne fut pas le cas.
De même, les textes rassemblés dans cette collection d’Occupational Punk refusent de sombrer dans le désespoir quant à l’existence humaine. Non pas parce que ce désespoir ne serait pas justifié, mais parce que chaque scénario rejette le fatalisme. Ces récits s’attachent plutôt à empêcher l’extinction de l’humanité — ou, du moins, celle de la profession d’ergothérapeute. Dans La maladie à la mort (1980), le philosophe danois Søren Kierkegaard décrit le désespoir comme la plus dangereuse des maladies — mais il voit aussi le désespoir comme un don. Pour Kierkegaard, il faut traverser une période de désespoir pour éventuellement parvenir à le surpasser. Le désespoir persiste seulement lorsque nous sommes empêchés d’imaginer ce qui pourrait advenir après notre fin.
Partir de la fin comme une possibilité
Le désespoir demeure donc un affect « négatif », mais il possède un potentiel révolutionnaire en nous poussant à penser depuis la fin, comme si la catastrophe avait déjà eu lieu. Dans On Extinction, Ben Ware (2024) mène une analyse philosophique de notre futur apocalyptique imminent. Plutôt que de fuir les recoins les plus sombres de notre imaginaire, Ware affirme que la politique radicale doit affronter la fin en la traversant. Citant Ernst Bloch : « La véritable genèse ne se trouve pas au début, mais à la fin » (2018, p. 44).
La tendance à catastrophiser est souvent pathologisée comme une forme d’anxiété — une propension excessive à imaginer le pire. Mais désirer la catastrophe, c’est désirer la fin de quelque chose : par exemple, la chute d’un ordre dominant qui dépend des interventions des ergothérapeutes pour se maintenir « durablement » en place. Ce désir peut être fécond s’il catalyse une révolte contre « le simple état des choses » (p. 92) et ouvre des espaces d’imagination pour autre chose. Dans cette optique, la fin de l’ordre actuel devient la condition nécessaire à l’émergence d’un monde différent.
Lorsque les ergothérapeutes investissent dans la croissance et le « développement durable » de leur profession, ils risquent de détourner l’attention de la possibilité plus radicale d’un monde dans lequel l’ergothérapie ne serait plus nécessaire — un monde qui ne handicape pas, n’isole pas, ne blesse pas. Un monde où l’ergothérapie devient obsolète (ou éteinte), et où l’humanité s’organise autour de la création collective de sens, plutôt que pour compenser les violences de l’ordre capitaliste néolibéral. Comme l’a dit Frederic Jameson : « Il semble plus facile aujourd’hui d’imaginer la détérioration totale de la Terre que la fin du capitalisme » (1994, p. xxi).
Temporalité
En imaginant la fin de l’ordre actuel, la question du temps devient centrale. Les autrices de cette collection situent la « catastrophe » sur des échelles temporelles très diverses. Certaines la placent dans un avenir indéfini, d’autres dans un futur variant entre un et sept cents ans. Bien que ces récits suivent des trajectoires variées, les angoisses qu’ils révèlent sont souvent enracinées dans le présent. L’une des plus marquantes : l’intrusion de la technologie et de l’intelligence artificielle — souvent décrites comme des menaces futures, pourtant déjà bien ancrées dans notre présent. En ce sens, le futur devient une simple projection du maintenant, voire sa répétition. Ware fait ici référence à la pulsion de mort selon Freud : une compulsion à répéter, une forme de blocage qui perturbe l’ordre mais empêche aussi toute forme de plaisir.
Pour Ware, affronter la fin de toutes choses n’est pas un geste nihiliste, au contraire : c’est le point de départ nécessaire pour réimaginer la temporalité du présent. Suivant la tradition marxiste, cette temporalité n’est ni neutre ni universelle : elle est façonnée par le mode de production. Le capitalisme produit le temps de façon inégale, et ses asymétries se ressentent dans les corps et les territoires, en affectant notre attention, nos émotions, notre plaisir. Le temps sous le capitalisme n’est pas qu’une répétition de l’accumulation — c’est la réalité existentielle d’êtres projetés vers leur propre fin.
Une finitude libératrice
Un texte de cette collection se distingue par son traitement poignant de la question universelle de la finitude humaine face à l’effondrement écologique. Dans Transhumance, Saïd-Gagné raconte le dernier jour de Pixel, un·e jeune sur le point de fêter ses 13 ans, aux prises avec une dépression réfractaire que même les traitements médicaux les plus avancés n’ont pu soulager. Après deux ans de démarches, sa demande d’aide médicale à mourir (AMM) est finalement acceptée.


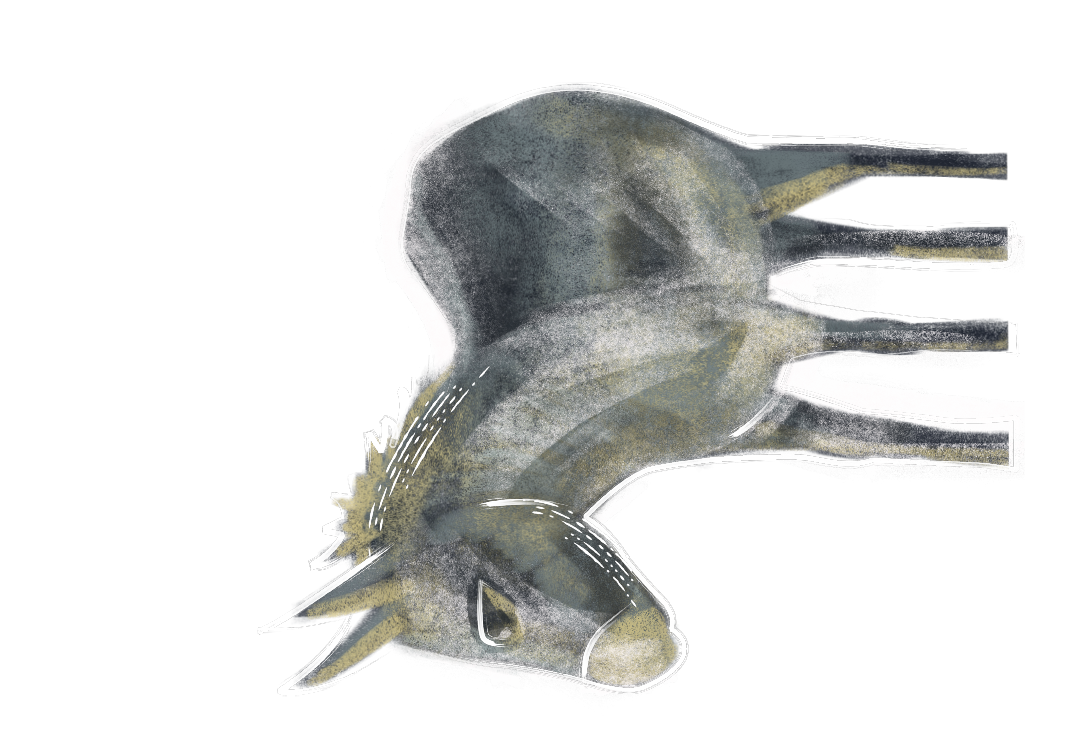
Ce jour-là, iel est autorisé·e à quitter le dôme — une enclave technologique de luxe réservée exclusivement aux riches — où iel vivait sous surveillance biomédicale constante. Un système de prise de décision « partagée », propulsé par l’IA, a déterminé le moment exact de sa mort. Le même système administrera l’injection létale, proposant une solution fluide et optimisée au désespoir qui a marqué sa courte existence. Le désespoir de Pixel, au sens kierkegaardien, est celui de « ne pas pouvoir mourir […] de ne même pas avoir l’espoir ultime de la mort » (p. 18).
Au Canada et dans d’autres pays occidentaux, l’AMM est présentée comme la culmination du principe de liberté individuelle, un symbole de progrès social. Or selon Ware, ce « progrès » n’est que le produit d’un mécanisme d’annihilation propre au capitalisme, qui exige de maîtriser tous les processus naturels — y compris la mort. Sous le couvert d’un désir d’émancipation, l’AMM peut devenir un autre outil de contrôle, renforçant l’étendue du contrôle biomédical sur tous les aspects de la vie.
En effet, Pixel vit dans un monde où chaque fragment de sa vie est comptabilisé, chaque minute soumise à une logique d’accumulation. Paradoxalement, son désespoir n’est pas résolu par l’AMM, mais par le désir qu’elle fait naître d’échapper à une existence saturée de contrôle entraînant une sensation suffocante de blocage — une vie « infiniment pire que la mort » (Ware, 2024, p. 15). La dépression devient alors un signal de rupture face à un monde incapable d’imaginer une forme de vie alternative.
Mais Pixel ne meurt pas. Avant même d’accéder à la procédure, iel perd le bracelet d’identification qui la relie à l’entreprise responsable du dôme et de l’AMM. Cette dissolution accidentelle de son identité devient la libération qu’iel espérait — une évasion du contrôle technologique. Pour Ware, l’extinction est déjà en cours — non pas comme un point final, mais comme un état d’épuisement, d’entre-deux, de « mort sans mourir » (p. 96). Hors du dôme, Pixel découvre une forme de liberté nouvelle, transgressive, née de la catastrophe. Le risque de mourir est réel, tout autant que celui de vivre autrement.
Le récit de Pixel fait écho, sur un autre registre, au troisième épisode de The Last of Us, centré sur l’histoire de Bill et Frank, deux hommes âgés formant un couple dans un monde en ruines. Contrairement au reste de la série, l’atmosphère dans cet épisode est plutôt paisible : l’infection s’éclipse, l’attention se porte sur l’amour, la vieillesse, les relations de soins. Frank, atteint d’une maladie dégénérative, demande à Bill de l’aider à mourir. Ils choisissent de partir ensemble, partageant un dernier verre de vin qu’ils ont soigneusement empoisonné. Contrairement à Pixel, leur mort n’est pas dictée par le désespoir, mais par l’amour et la reconnaissance partagée que leur vie est arrivée à terme. Leur suicide ne relève pas de la fuite, mais de la présence : un geste ultime d’agentivité dans un monde autrement marqué par la perte.
Cesser de craindre la peur… et en rire
Notre réalité matérielle est de plus en plus décrite comme une polycrise — un terme proposé par Edgar Morin dans les années 1990 qui désigne aujourd’hui la convergence des guerres coloniales, de l’effondrement écologique et de la menace nucléaire. Chacune de ces crises réactive le fantasme de mettre fin au blocage suffocant qui marque le capitalisme tardif. Alors que le désespoir s’approfondit, certains pays comme le Royaume-Uni ou la France s’apprêtent à mettre en œuvre une forme d’aide médicale à mourir. D’autres, dont le Canada, passent à l’action et proposent désormais d’élargir cette procédure fatale à des enfants et aux personnes vivant avec des troubles mentaux.
Mais affronter l’extinction ne viendra pas en résistant le déclin supposément universel de l’humanité. Ces tentatives risquent plutôt d’en renforcer l’élan. Le travail universitaire, comme celui des soins, participe souvent à cette inertie — dans une répétition compulsive qui mime la pulsion de mort. Cette inertie n’a rien de neutre ni de progressiste. Si la résurgence du fascisme et des guerres néocoloniales n’a pas déjà sorti certains collègues de leur confort académique, qu’est-ce qui le fera ?
Si nous devons vivre dans l’ombre d’une sixième extinction de masse, Ware plaide pour le développement d’une nouvelle capacité à avoir peur — une orientation affective qui cultive le désir de catastrophe, ce qu’il appelle « un nouveau sens de l’apocalyptique » (p. 23). Cela exige, dit-il, « le courage d’être effrayé, et d’effrayer les autres » (ibid). Mais devenir des « prophètes éclairés du malheur » (Dupuy, 2009) n’implique ni action précipitée ni fuite vers une autre galaxie. Il s’agit plutôt de réinventer collectivement ce que signifie être humain — ici, maintenant, au milieu des ruines.
Ware termine en soulignant la nécessité de rire, comme geste radical face à la catastrophe. Notre situation actuelle, rappelle-t-il, « n’est rien d’autre qu’une mauvaise blague » (p. 111). En dévoilant les absurdités du présent, le rire devient une forme de résistance pour celles et ceux qui, comme Sara Ahmed (2023), ne peuvent plus se permettre le luxe de l’optimisme. S’il existe une manière de se préparer à l’avenir, elle ne viendra ni de la science ni de la fiction — mais de notre capacité à affronter la catastrophe ensemble, dans les liens fragiles et insoumis de notre humanité en péril.
Références
Ahmed, S. (2023). The feminist killjoy handbook: The radical potential of getting in the way. Hachette UK.
Bloch, E. (2018). On Karl Marx. London: Verso.
Dupuy, J.-P. (2009). The Precautionary Principle and Enlightened Doomsaying: Rational Choice before the Apocalypse. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities 1(1), pp. 1–13.
Jameson, F. (1994). The Seeds of Time. New York: Columbia University Press.
Kierkegaard, S. (1980). The sickness unto death (H. V. Hong & E. H. Hong, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1849)
Ware, B. (2024). On Extinction: Beginning Again at the End. New York: Verso.